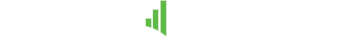Le mix électrique algérien est, aujourd’hui, très largement dominé par le recours au gaz naturel puisque près de 99% de la production d’électricité domestique est assurée par ce biais. Environ 20 milliards de mètres cubes en 2019, ce chiffre représentera 23 milliards de mètres cubes annuellement à horizon 2028 sur la base d’un scénario de croissance conservateur de 2 à 3% par an.
Par Adnane Belahcen,
avocat au barreau de Paris
Il va sans dire que cette situation est en nette opposition avec les tendances mondiales observées en la matière qui, toutes, concourent vers une transition écologique et militent pour une utilisation moins intensive des énergies fossiles et leur remplacement par les énergies renouvelables.
Mais de «choix de l’époque», ce développement rapide des énergies renouvelables est surtout en train de s’imposer pour l’Algérie comme un choix raisonné et quasi optimal :
D’abord, en termes de ressources, l’Algérie souffre d’un épuisement relatif de ses réserves initiales en hydrocarbures. Sans retenir les scénarios alarmistes prévoyant la fin des exportations de gaz naturel à horizon 2032 (1), l’augmentation croissante de l’utilisation du gaz naturel pour des besoins domestiques, et en particulier de production d’électricité, est susceptible de créer une tension sur la disponibilité de la molécule pour l’export et, de ce fait, contraindre la politique commerciale de Sonatrach et de l’Etat algérien en matière d’export.
Ensuite économiquement, devoir favoriser la consommation domestique au détriment de l’export représentera un manque à gagner considérable pour l’Algérie.
Très largement subventionné, le prix du kwh payé par le consommateur algérien ne reflète, en effet, ni le coût de production du gaz naturel ni le coût d’opportunité que représente le prix de vente de la molécule à l’export.
Chaque mètre cube consommé pour les besoins de production d’électricité représente un manque à gagner pour Sonatrach et, donc, pour l’Etat algérien.
Enfin structurellement, l’Algérie peut, en, raison de ses atouts, œuvrer à la mise en place d’un mix électrique dans lequel les énergies renouvelables occupent une place prépondérante :
– le niveau de radiation dont bénéficient de nombreuses régions algériennes est l’un des plus élevés du monde – il permettra nul doute des taux de conversion extrêmement intéressants ;
– l’Algérie dispose d’un réseau de transport d’électricité relativement développé qui lui permettra d’acheminer l’électricité produite par des parcs solaires situés dans le Sud du pays vers le littoral, où se concentre une partie importante de la consommation d’énergie électrique ;
– le parc de production d’électricité de Sonelgaz est quasi exclusivement composé de turbines à gaz et de centrales à cycle combiné, des moyens de production flexibles qui peuvent aisément intervenir pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables.
Choix optimal et raisonné, le pari du renouvelable est, par ailleurs, conforté par autant d’indicateurs et de signaux internationaux qui, à n’en pas douter, doivent conforter l’Algérie dans une démarche de transition vers le renouvelable.
En premier lieu, le coût de revient du kwh de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire, et en particulier le photovoltaïque, est en baisse constante (2). Les derniers projets PV tunisiens ont été attribués à un tarif inférieur à trois (3) centimes de dollar par kwh.
Par ailleurs, le recours à une énergie décarbonée signifie aussi un accès privilégié à une abondance de liquidités chez les prêteurs multilatéraux (de type BAD, SFI…..).
Il existe, en effet, aujourd’hui un appétit grandissant de la part des institutions financières internationales pour financer la construction de moyens de production d’électricité fonctionnant aux énergies renouvelables à des conditions financières extrêmement avantageuses.
Il convient, d’ailleurs, de souligner que les pouvoirs publics algériens semblent avoir parfaitement intégré ces données : les différents ministres de l’Energie, qui se sont succédé depuis 2016, ont tous confirmé le caractère stratégique de l’intégration des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’énergie solaire, dans le bouquet électrique algérien.
Le plan solaire 4 000 MW, annoncé il y a quelques années, avait suscité l’enthousiasme de la communauté des développeurs internationaux ainsi qu’un intérêt certain de la part des institutions financières de développement, et ce, malgré le peu de visibilité fournie par les pouvoirs publics sur la structure qui sera adoptée pour la mise en œuvre de ce plan.
Si certains freins s’étaient, à l’époque, malheureusement interposés pour ce développement, la période actuelle constitue, à n’en pas douter, un moment propice à une résurgence et un renouveau conforté de ces ambitions.
L’analyse des récentes réformes ayant graduellement permis l’avènement d’un environnement favorable aux investissements étrangers, révèle d’ailleurs qu’une partie des prérequis nécessaires au développement de nouveaux projets de production indépendante d’électricité dans le domaine du renouvelable, est maintenant satisfaite en Algérie.
Les récentes avancées permettant le développement des énergies renouvelables
L’Algérie a, au cours des cinq (5) dernières années, conduit d’importantes réformes visant à promouvoir les investissements étrangers et réduire les contraintes qui pesaient, jusqu’alors, sur les opérations d’investissements directs en Algérie.
Ces réformes, qui ont été menées de façon graduelle depuis la loi 16-09 jusqu’à la récente promulgation de la loi de finance complémentaire pour 2020, sont de notre point de vue susceptibles d’attirer de nombreux développeurs internationaux dans le cadre d’un éventuel appel d’offre international, portant sur le plan solaire visé ci-dessus. Nous faisons, en particulier, référence aux éléments suivants :
– La suppression de l’obligation pour les investisseurs étrangers de présenter une balance commerciale excédentaire. En effet, jusqu’en 2016, les investissements directs étrangers devaient présenter une balance commerciale excédentaire au bénéfice de l’Algérie et ce, tout au long de la durée de l’investissement.
En d’autres termes, les investisseurs étrangers ne pouvaient transférer à l’étranger des montants supérieurs à ceux qu’ils avaient investis en devises étrangères.
Cette règle, combinée à l’interdiction qui prévalait à l’époque de recourir à de la dette bancaire étrangère, réduisait de manière significative le montant des dividendes ou des produits de liquidation d’investissement, que les opérateurs étrangers étaient habilités à rapatrier dans leur pays d’origine.
La suppression de cette règle et la consécration (sous certaines réserves de seuil de capital investi) du principe de libre transfert à l’étranger des capitaux investis et de leurs produits, est de nature à rassurer les investisseurs internationaux.
– La suppression de la règle 49/51 pour les secteurs autres que stratégiques par la loi de finance complémentaire 2020, et l’exclusion du secteur de la production d’électricité du champ d’application de cette règle, contribuera nul doute à attirer davantage d’investisseurs internationaux soucieux pour des raisons de consolidation comptable et de contrôle de leur outil industriel, de disposer de la majorité du capital social des véhicules de projet. Cette réforme était très attendue par la communauté des investisseurs internationaux. Sa concrétisation -même partielle à ce stade – a constitué un signal fort en leur direction.
– La suppression du droit de préemption de l’Etat, pour tout projet de cession d’actions détenues par un investisseur étranger dans le capital d’une société algérienne, était très largement attendue par les investisseurs internationaux, en raison de l’absence de règles claires encadrant les termes et conditions de l’exercice par l’Etat dudit droit.
Sa suppression dans le cadre de la loi de finance complémentaire 2020, et son remplacement par une procédure d’autorisation préalable, qui ne concerne que les secteurs dits stratégiques (dont le secteur de la production d’électricité ne fait pas partie) est un signal positif émis en direction des investisseurs internationaux.
– La fin de l’interdiction de recourir aux financements internationaux dans le cadre de la loi de finance complémentaire 2020 – une mesure initialement prise dans un contexte très particulier, en 2006, sur abondance des liquidités en Algérie – était extrêmement attendue par les investisseurs internationaux, en particulier les producteurs indépendants d’électricité en raison, notamment, des conditions commerciales extrêmement favorables que certaines institutions financières internationales offrent pour ce type de projet.
Enfin, la réussite de tout projet de production indépendante d’électricité requiert, qu’il s’agisse d’un projet d’énergie conventionnelle ou renouvelable, la mise en place d’un cadre contractuel robuste à même de protéger les intérêts des investisseurs et des prêteurs internationaux. Il s’agit, ici, d’un point clé qui conditionne la décision même des sponsors de répondre à un appel d’offres et de formuler une offre technique et commerciale.
Si les documents d’appel d’offres (et en particulier, les documents de projet dont le contrat d’achat, de vente d’énergie électrique et l’accord-cadre) ne correspondent pas aux pratiques de marché, en termes d’allocation de risques ou sont jugés comme non «bancables», il est alors probable que peu d’investisseurs décident de participer au processus d’appel d’offres.
La qualité du dossier d’appel d’offres est jugée, à raison, par les investisseurs comme un gage du sérieux de la démarche de l’acheteur d’électricité et de sa volonté réelle de conduire le processus de développement du projet jusqu’à son terme.
A la recherche d’un cadre contractuel standardisé et bancable
Dans ce cadre, les investisseurs et les prêteurs internationaux potentiels procéderont à un examen minutieux du cadre contractuel applicable au projet, et des termes de l’appel d’offres et, en particulier, aux termes et conditions contractuelles proposées. Parmi les points, qui seront scrutés avec minutie, figurent :
1. Une matrice de risque équilibrée. La nécessité que la documentation contractuelle, proposée dans le cadre de l’appel d’offres, reflète une allocation des risques entre les parties conformes à la pratique de marché.
Cette allocation de risque doit être équilibrée entre l’acheteur d’électricité et l’investisseur, et doit procéder du principe selon lequel chaque risque doit être assumé par la partie la mieux en mesure de contrôler sa survenance.
Ainsi, si le risque exploitation peut être entièrement assumé par l’investisseur, les stipulations du contrat d’achat et de fourniture d’électricité doivent prévoir des mécanismes de protection des revenus de l’investisseur, en cas de matérialisation d’un risque réseau (incapacité du réseau de transport d’électricité pour quelque raison que ce soit, de prendre livraison de l’énergie électrique produite par un parc solaire) ; ou d’un risque dit politique (changement de loi ou autre évènement de nature politique empêchant l’investisseur de construire ou d’exploiter la centrale ou augmentant ses coûts de manière significative).
2. La prise en charge par l’acheteur du risque politique. S’agissant plus particulièrement du risque dit «politique», il ne fait nul doute compte tenu des dernières évènements politiques survenus en Algérie, et des mesures qui avaient été prises par les autorités algériennes entre 2006 et 2010, globalement perçues comme hostiles aux investissements étrangers, que les sponsors seront attentifs à ce que le niveau de protection qui leur est accordé, dans ces circonstances, soit le plus exhaustif possible.
Ainsi, en cas de survenance de ce type d’évènement empêchant le parc solaire d’être exploité, outre le régime classique qui octroie le droit à l’investisseur (i) d’être rémunéré à un niveau équivalent à celui qu’il aurait perçu, si le parc avant été en fonctionnement, (ii) le droit de résilier le contrat si cette situation perdure, et de (iii) percevoir une indemnisation au moins équivalente à la dette contractée pour le projet plus les capitaux propres non amortis, les investisseurs seront extrêmement attentifs au champ d’application de ce régime et, donc, aux événements précis dont la survenance les autorise à s’en prévaloir.
Enfin, et compte tenu des légères incertitudes qui pèsent encore dans la réglementation des changes sur le principe de libre transfert à l’étranger des capitaux investis et de leurs produits, il conviendra que ce point soit spécifiquement garanti aux investisseurs et aux prêteurs internationaux.
3. Garantie des frais d’énergie. La nécessité que le paiement des frais d’énergie, que l’acheteur doit verser au vendeur, soit garanti par le biais d’un instrument liquide (lettre de crédit) couvrant un à deux mois desdits frais.
Il est usuellement requis que cette lettre de crédit prenne la forme d’une garantie autonome et à première demande émise ou contre garantie par une banque internationale de premier rang. Cette exigence est généralement portée aussi bien par les investisseurs que par les prêteurs internationaux.
4. Sécurisation de l’assiette foncière du projet. Les projets de production d’électricité à partir de sources renouvelables, et les projets photovoltaïques, en particulier, requièrent une assiette foncière relativement importante.
Cette assiette foncière doit être identifiée et sécurisée en amont par l’entité en charge d’initier l’appel d’offres, afin d’en garantir la jouissance paisible à l’investisseur.
Il est important de noter ici que les institutions financières internationales exigent lorsque que cette assiette foncière est propriété des populations locales que le transfert de propriété au profit de l’acheteur d’énergie ou de l’investisseur suive une procédure de gré à gré à l’exclusion de toute procédure d’expropriation forcée. A défaut de quoi, lesdites institutions ne participent pas au financement du projet en question.
Il s’agit ici de l’application des principes Equateur, un ensemble de règles ayant trait à la responsabilité environnementale et sociale dont le respect conditionne la participation de certains prêteurs multilatéraux à ces projets.
5. Nature des droits octroyés à l’investisseur sur le site. Il est usuel que les investisseurs, secondés par les prêteurs internationaux, demandent qu’un droit dit réel leur soit consenti sur le site du projet.
Cette demande peut être satisfaite par le biais d’un bail emphytéotique qui octroie au locataire un droit de propriété sur les constructions érigées sur le site. De cette manière, l’investisseur sera réputé propriétaire du parc solaire et sera en mesure de l’hypothéquer au profit des prêteurs.
Ce point revêt une importance particulière compte tenu du mode de financement de ce type de projets. S’agissant, en effet, d’un schéma dit financement de projet, les prêteurs ne disposent pas de recours contre les actionnaires en cas d’échec du projet, et ne peuvent, donc, se rembourser que sur les actifs du projet.
Enfin, idéalement, un accès au site du projet devrait être octroyé aux investisseurs le plus tôt possible durant la phase de développement du projet, afin que le risque géotechnique et géologique, durant la période de construction, soit assumé par les sponsors.
A défaut, ce risque devra être pris en charge par l’acheteur, qui devra s’engager à compenser l’investisseur des éventuels frais supplémentaires encourus en raison d’une condition du site, qui aurait pour effet de retarder le déroulé des travaux ou d’augmenter leurs coûts.
6. Couverture des risques de change. Une partie du tarif de vente de l’énergie, produite par le parc solaire, devra être libellée en devise étrangère et ce, afin de couvrir les frais de l’investisseur libellés en ces devises.
7. Garantie du paiement des montants de résiliation. Le contrat d’achat et de fourniture d’électricité comprend, traditionnellement, un mécanisme permettant la résiliation du contrat avant son terme, en cas de non-respect par une des parties de ses obligations contractuelles, ou de survenance d’un cas de force majeure (politique ou naturelle) prolongée.
Cette résiliation s’accompagne dans presque tous les cas d’une compensation à verser à l’investisseur, dont le montant dépend de la cause de résiliation.
Ainsi, une résiliation consécutive à un cas de défaut de l’investisseur (faible performance du parc solaire par exemple) ouvre généralement, au profit de ce dernier, à un montant lui permettant de couvrir la dette restant due aux banques – l’investisseur perdant le bénéfice de ses capitaux propres.
Lorsque la résiliation est consécutive à un cas de défaut de l’acheteur (non-paiement des frais d’énergie, par exemple), cette compensation couvre généralement au moins la dette restant due aux banques plus les fonds propres non amortis, voire une partie des bénéfices qu’il aurait réalisés si le contrat était allé jusqu’à son terme.
Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, ces montants dits «montants de résiliation» font traditionnellement l’objet d’une garantie souveraine, une garantie émise par l’Etat d’accueil.
Une expérience prouvée en matière de développement de ce type de projets
Il convient de noter ici que, contrairement à une idée répandue, l’Algérie dispose d’une expérience significative en matière de développement de projets de production indépendante d’électricité, dans le cadre d’un schéma de financement sans recours.
En effet Sonelgaz et Sonatrach ont participé, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, au développement de nombreux projets IPP et IWPP, dans le cadre de ce type de schémas. Leurs équipes sont, par conséquence, parfaitement au courant de ces prérequis et des exigences des prêteurs internationaux en la matière.
Et même si certains de ses projets furent in fine financés par les banques locales à la suite d’une décision prise par les pouvoirs publics, la documentation contractuelle négociée à l’époque répond globalement à nombre des préoccupations traditionnelles des sponsors et des prêteurs internationaux.
Cette documentation pourra utilement servir de base au cadre contractuel devant être mise en place et être adaptée pour prendre en compte les évolutions que le marché a connus, depuis les derniers projets développés dans le cadre de ce schéma, afin de bâtir un projet attractif et susciter la plus large concurrence possible.
A. B.
Note :
- De notre point de vue, ces prévisions ne prennent pas en compte l’action sur la production de gaz naturel.
- Une baisse d’environ 90% a été constatée entre 2010 et 2021 sur le marché international.
Bio express
Adnane Belahcen est associé du cabinet Lincoln Legal Services, un cabinet d’avocats dédié au développement des grandes infrastructures en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Maître Belahcen a conseillé de nombreux investisseurs internationaux dans le cadre du développement de leurs projets industriels en Algérie. Il est, par ailleurs, très familier avec le modèle IPP algérien, pour avoir conseillé de nombreux sponsors dans le cadre de ce type de projets.
Pour plus d’informations :
www.lincoln-ls.com
adnane.belahcen@lincoln-ls.com